
Charge de la cavalerie française à Reichshoffen.
C’est l’un des épisodes les plus célèbres de la Guerre franco-prussienne. Celui qui a bercé le coucher des enfants mais aussi entretenu les flammes de l’espoir entre 1871 et 1914 : la bataille de Reichshoffen !
Août 1870 : après avoir perdu la bataille de Wissembourg, le maréchal français Patrice de Mac-Mahon décide de stopper l’avance ennemie à Frœschwiller, non loin de Woerth, dans le nord du département. Pour se faire, il dispose de plusieurs corps d’armée : les 1er, 5ème et 7ème ; mais à la veille de la bataille seul le 5ème est opérationnel qui, heureusement est bientôt rejoint par la 1ère division du 7ème corps d’armée de Dumesnil. La fine fleur de la cavalerie française est présente : régiments de hussards, de lanciers, de chasseurs à cheval, mais aussi et surtout les 1er, 2ème, 3ème, 4ème 8ème et 9ème régiments de cuirassiers. Pour autant, face aux 90.000 prussiens, les Français n’alignent que 50.000 hommes.
Le blog www.hdebougareyt.blogspot.fr présente le récit d’un survivant du 9ème ; il s’agit de Jean Pons, qui raconte à sa belle-fille la charge fameuse : « Ce samedi 6 août 1870, en Alsace, dans un vallon entre Niederwald et Eberbach près de Woerth, la journée se lève maussade, nuageuse ; déjà vers les 7 heures des tirs d’armes légères et d’artilleries sont perçus. Le maréchal des logis transmet les ordres : le temps presse, seuls les cavaliers se préparent, les hommes à pied, chevaux de trait, cantines, bagages restent sur place sous la protection d’éléments du 4ème peloton.
Les chevaux sont nerveux, rapidement abreuvés et nourris, ils sont harnachés ; puis chacun d’entre nous s’affaire pour ne rien oublier et malgré l’estomac noué, tacher de manger un morceau de pain et de boire un peu d’eau. Pendant un long moment les chevaux sont tenus à la bride en attendant la transmission des ordres.
Vers les 13 heures, le trompette, malgré sa blessure aux lèvres et deux dents cassées, causée suite à un écart de son cheval en plein galop alors qu’il jouait pour transmettre les instructions, sonne le rassemblement du 9ème, suivi en cela par celles du 8ème puis des lanciers. Notre chef, le colonel Waternaud présente le 9ème au général Michel lequel se dirige ensuite vers le 8ème, commandé par le colonel Guiot de la Rochére et enfin vers les deux escadrons du 6ème lanciers aux ordres des capitaines Lefèvre et Pouet. Il reçoit les honneurs puis s’adresse à nous tous ; trop loin, je ne saisi que quelques bribes : « Mes enfants …sans vous l’armée est perdue...nous allons bousculer ces prussiens….la bataille sera rude….le salut de la France …. vos familles…. sont entre vos mains…. Régiment …garde vous…sabre à la main …en avant... ».
Ce fut pour moi un moment terrible : dans un piétinement formidable les 1.100 cavaliers en ordre de bataille s’ébranlent, le 8ème en tête, nous derrière, puis enfin les deux escadrons du 6ème, au pas d’abord, puis rapidement au trot et très vite au galop ; nous sommes presque botte contre botte comme pour mieux nous unir, nous soutenir, nous protéger devant l’inconnu. Nous crions ou plutôt nous hurlons, pour faire fuir l’adversaire ? Je ne le crois pas, peut-être chasser notre peur car lorsque l’on hurle l’on ne pense à plus rien ; j’entends même des : « vive l’empereur ! » et« vive la France ». Plus nous avançons, plus nous nous rapprochons de l’ennemi moins nous réfléchissons : oubliés balles, obus percutants, lances acérées, sabres, un seul but bousculer, renverser, anéantir le prussien !
Devant nous le flanc de la colline est couvert de houblonnières, de champs de lin, de blé qui n’a pu encore être fauché, de vergers avec leurs pommiers bas, un peu comme chez nous, de quelques vignes mais également de prés avec des souches recouvertes d’herbe qui représentent autant de pièges dangereux pour notre charge.
Tout est rapidement dévalé mais à quel prix ! Dans les vignes des fantassins en embuscade nous tirent, sur la terre lourde et grasse nos lourds chevaux glissent entrainant dans leurs chûtes cavaliers et d’autres chevaux ; dans les vergers biens des nôtres sont jetés à terre, désarçonnés par les branches des pommiers, le pire : le premier escadron de mon régiment est mis hors de combat en se précipitant au galop du haut d’un champ dans un petit chemin profond en contrebas ! Malgré les tirs nourris des fantassins et des obus percutants ou à balles qui causent des pertes dans nos rangs, très vite la charge se rapproche de Morsbrönn.
La grosse partie de notre régiment derrière le lieutenant-colonel Archambault de Beaune appuie sur la droite et brusquement se trouve face à plusieurs bataillons de l’infanterie prussienne dont une compagnie de pionniers ; devant notre masse déferlante ils n’ont pas le temps de se former en colonnes d’attaques mais rapidement se regroupent et forment le carré. Il parait solide, impénétrable, le premier rang, arc-bouté, avec ses longues baïonnettes, dresse un mur hérissé, le second rang nous pointe de ses fusils, le troisième prêt à son tour à tirer dès la salve du second. Soudain un nuage gris s’élève du carré, aussitôt un crépitement assourdissant suivit de chocs, d’impacts, de ricochés sur nos cuirasses, mais aussi de sang et de cris. La fumée s’élèvent, je distingue un grand nombre de chevaux qui passent comme des ombres sans cavalier, d’autres, leurs malheureux maîtres un pied pris dans un étrier sont trainés et tels des corps désarticulés rebondissent sur tous les obstacles; le pire, c’est cette douloureuse rumeur faite de cris, de râles, de gémissements, d’hennissements qui s’élève du sol ou jonchent hommes et chevaux … Nous nous reformons poursuivi par la mitraille et aussitôt, plein de hargne, nous repartons à la charge.
Des camarades, enfonçant les éperons, font sauter leurs chevaux par-dessus ce mur de baïonnettes pour retomber dans les lignes prussiennes ; puis par de larges moulinets de leurs longues lattes creusent des vides chez l’ennemi, créant une certaine désorganisation dans ses rangs avant que ne s’écroulent leurs montures ensanglantées ou éventrées. Profitant de ce relâchement, avec d’autres camarades, couchés sur nos chevaux, sabrant de droite, de gauche nous arrivons à pousser nos chevaux entre les colonnes ennemis et leur causer grand dommage. Par trois fois nous avons enfoncé le carré, par trois fois nous nous sommes retirés, chaque fois hélas moins nombreux. Deux fois j’ai eu un cheval tué sous moi. Comme nous l’avions appris à l’exercice, l’important pour sa survie est de ne pas rester démonté. Grace à une énergie inconnue, insoupçonnée devant le pire mais aussi par chance, j’ai toujours pu, malgré mes bottes et ma lourde cuirasse qui limite les mouvements, vivement me dégager, courir sous les balles, sauter par-dessus des corps, sans perdre mon sabre grâce à sa dragonne, éviter les autres cavaliers, chercher, saisir par la crinière un cheval affolé, et réussir à me hisser sur son dos puis repartir vers l’enfer.
Je me souviens de nos grands sabres rouges de sang jusqu’à la garde, je revois des camarades avec des balafres, les yeux pleins de sang s’essuyer en riant d’un air féroce ; d’autres rient bruyamment comme s’ils avaient fait une bonne farce ; de mon côté je cherche des visages amis de mon peloton mais hélas, personne, tous sont couchés là-bas, pour eux tout est fini, pour nous tout est à recommencer.
Mais vois-tu, le plus impressionnant c’est le regard des hommes que nous combattons, regard si rapproché lors des contacts que nous y voyons le reflet du nôtre et pouvons y lire nos propres sentiments de peur, de colère, de haine, de méchanceté, d’imploration mais aussi curieusement parfois de compassion (c’est si facile d’appuyer un peu plus ou un peu moins avec le sabre !).
Ces furieux coups de boutoirs ont anéanti les pionniers qui cèdent et battent en retraite pour se réfugier dans les vignes et houblonnières. Le trompette sonne le ralliement, rapidement, mais sous les obus nous reprenons notre chevauchée. Déjà nous voici aux abords de Morsbrönn et y accédons par un chemin encaissé ou la mitraille des fantassins cachés au-dessus se fait plus violente. Plusieurs des nôtres sont arrêtés net dans leur élan, d’autres glissent lentement sur le dos de leurs montures puis soudain roulent et tombent.
Couchés sur l’encolure de nos chevaux, le regard fixe, le sabre en avant nous nous engouffrons dans la grande rue ; de chaque ouvertures, fenêtres, portes, un fusil est pointé et fait feu, la rue se rétrécie, l’on n’y voit plus rien cependant des cris, des hurlements, des crépitements incessants font penser qu’un drame se déroule un peu plus haut mais une courbe nous bloque la vue. Sans ralentir nous la dépassons, puis de suite une seconde et là nous nous écrasons sur nos camarades bloqués par un obstacle, en effet des charrettes et quelques autres objets placés en travers de la rue obstruent la sortie du village.
Le crépitement continu des fusils nous assourdit et nous affole, ils nous fusillent à bout portant, si près que parfois la tunique brûle autour de la plaie. Les hommes hurlent, les chevaux hennissent, ruent, piétinent les malheureux au sol, d’autres sautent sur le dos d’autres chevaux comme voulant s’échapper de cet enfer mais blessent les cavaliers. Je vois des hommes à terre levant la main comme voulant se protéger des sabots des chevaux, d’autres malgré leurs blessures tentent de se lever. Bloqués par d’autres chevaux dans cette rue et tournant en rond sur place sous la mitraille, l’horreur est d’entendre des craquements et des cris de suppliciés lorsque nous piétinons nos camarades, hélas dans ces instants chacun ne pense qu’à sauver sa peau. Une nouvelle fois mon cheval est tué. Par grande chance je réussi une fois de plus à me dégager et dans la bousculade me saisir d’un autre.
Chacun d’entre nous fait ce qu’il peut, sabre çà et là dans les fenêtres lorsqu’un coup de feu part ou au hasard dans chaque recoin. Dans la bousculade arrivent maintenant les lanciers ajoutant à la confusion. Nous tournons comme au carrousel cherchant une issue pour échapper à cette pluie mortelle mais tout est bloqué. Dans cette bousculade les lanciers sont gênés par leurs lances et en les manœuvrant blessent au visage bon nombre des nôtres par les extrémités des hampes. Cependant ils sont d’une grande efficacité pour débusquer les tireurs à l’étage et peu à peu l’intensité des tirs s’apaise. Enfin des hommes démontés ont réussi courageusement à dégager le passage, aussitôt nous pouvons nous libérer de ce piège.
Alors que les coups de feu ont pratiquement cessés à la sortie du village nous faisons halte à l’abri d’un petit bosquet. Nous pouvons nous retrouver, nous reconnaitre, nous compter. L’horreur ! Un tout petit nombre de cavaliers, quelques petites dizaines, inférieures aux doigts d’une main tout corps confondus, du 9ème il me semble n’en apercevoir que 8.
Les chevaux sont harassés, de leurs gueules une bave mélangée de sang s’écoule, leurs flancs tremblent, nos bras sont lourds, les poignets et les cuisses nous font mal, chacun a des blessures plus ou moins impressionnantes, du sang macule nos tuniques mais curieusement personne n’en souffre vraiment encore. A la vue de ma cuirasse bosselée et percée légèrement à un endroit, bêtement je me dis : « Jean tu vas faire de la salle de police pour avoir abimé ta cuirasse et ils vont te faire payer la réparation ». Je sursaute car je me rends compte à l’instant que je monte un cheval du 6ème lancier.
Progressivement nous reprenons nos esprits, commençons à parler, à prendre conscience de la situation, que nous sommes vivants, le reste… Quelques camarades se sont retirés de quelques pas et debout sur les étriers soulagent leur vessie. Soudain deux s’écrient « ils sont là ! Ils arrivent ! » Ces mots nous figent mais aussitôt nous reconditionnent, pas de temps à perdre l’endroit n’est pas propice pour combattre. Un gros capitaine avec de grandes moustaches étant le plus vieux et le plus haut gradé s’octroie le commandement. Il nous fait prendre le galop pour essayer de nous soustraire à l’ennemi, mais nos pauvres chevaux harassés ne peuvent soutenir le train. Le capitaine nous fait arrêter ; de nous-mêmes nous faisons demi-tour et nous plaçons en ligne de bataille, prêt pour l’assaut, le capitaine brièvement nous harangue : « Camarades montrons aux prussiens qui nous sommes … pistolet en main … pointez … feu ! ».
Ceux d’en face, des hussards du 13ème, ralentissent et s’arrêtent surpris devant un tel sursaut et du danger encouru. Le tir n’a pas un grand résultat ; le capitaine se retourne vers nous, lève son sabre et d’une voie forte s’écrie : « Vive la France … Sabre en main … Chargeons … ». Voyant cela, les prussiens éperonnent et s’élancent vers nous pour engager le combat.
Les sabres crissent sur les cuirasses, les chevaux soufflent, les lances montent ou descendent, nos grands sabres s’allongent, des cris s’élèvent, les hommes se courbent pour piquer en dessous, les chevaux furieux se dressent et se mordent en hennissant d’un ton terrifiant, des hommes tombent, des chevaux s’écroulent ».
« C’était un soir la bataille de Reichshoffen
Il fallait voir les cavaliers charger.
Ils étaient là alignés dans la plaine
Le sabre au clair, le pied à l’étrier
Attention cavaliers, chargez ! »

Rescapés de Reichshoffen – Eglise de la Madeleine, Paris, 1917 (copyright BNF).

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)
/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)
/image%2F1492174%2F20210701%2Fob_230215_bataille-issy.png)

/image%2F1492174%2F20160115%2Fob_7fb782_lasserre-issy.jpg)





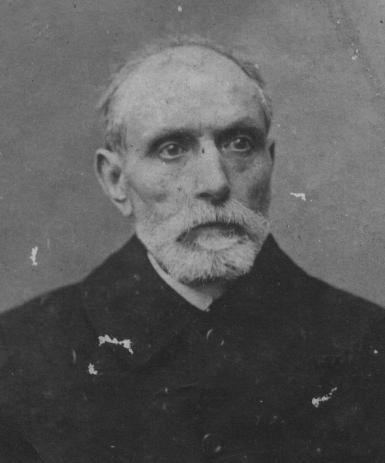










/image%2F1492174%2F20210817%2Fob_5dcaf2_gambetta-ballon.jpg)

