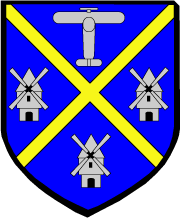Publié le 28 Septembre 2012
Char nord-coréen en 1948.
Yalta et ses conséquences.
La Conférence de Yalta, en février 1945, rassemble Josef Staline, chef de l’Union Soviétique, Franklin Roosevelt, président des Etats-Unis et Winston Churchill, Premier ministre de Grande-Bretagne. Il s’agit pour ces puissances, qui sont en train de vaincre l’Allemagne nazie et ses alliés, de se donner les moyens d’établir partout où sont installées des troupes ennemies, les bases du rétablissement de la paix. Ceci en langage diplomatique. Traduit en termes d’intérêts, cette conférence consiste aussi et surtout à affirmer un partage de « zones d’influence ».
A Yalta, l’Union soviétique donne également son accord pour se retourner vers l’ennemi japonais, trois mois après l’anéantissement de l’Allemagne. Aussi, le 9 août 1945, au lendemain de sa déclaration de guerre à « l’Empire du soleil levant », les troupes russes pénètrent dans le nord de la Corée pour y chasser les derniers bataillons japonais. Au sud, les Américains font de même dans le courant du mois de septembre 1945 : il a en effet été décidé que le 38ème parallèle servirait de « frontière » entre la zone d’influence soviétique et celle d’influence américaine.
Deux idéologies s’affrontent : au nord, sous influence soviétique, hégémonie est donnée aux idées révolutionnaires communistes. Au sud, en juillet 1948, se déroulent les premières élections : Syngman Rhee (1875-1965) devient président de la République coréenne, lui qui fut déjà par la passé, président du Gouvernement provisoire de la République de Corée, pendant l'occupation japonaise, de 1919 à 1925.
En réponse à ce qui est considéré comme une provocation, en septembre de la même année, la République Populaire de la Corée du Nord est proclamée, et Kim Il-sung (1912-1994) en est le Premier ministre, poste qu'il occupera jusqu'en 1972 avant de devenir président de «sa» Corée, et cela jusqu'à sa mort en 1994.
Inutile de préciser que ces deux partis revendiquent chacun l'intégralité de la Corée...
Invasion du sud.
Après avoir reçu les assurances de soutien de Staline et du dirigeant chinois Mao Zedong, Kim Il-sung lancent 135.000 hommes à l’assaut de la frontière du 38ème parallèle. Auparavant, il a pris soin de procéder à un gigantesque tir d’artillerie. Avec l’ouverture des archives soviétiques, il apparait aujourd’hui clairement qu’il s’agit d’une initiative de Kim Il-sung, et non d’une réponse à des tentatives de déstabilisation, comme cela fut souvent indiqué à l’époque, entre autres par une certaine intelligentsia communiste des pays occidentaux. En fait, le Premier ministre nord-coréen couve ce projet depuis sa nomination en 1948.
La Corée du Sud et son allié américain sont totalement pris de cours. Aux Nations unies, l’Union soviétique joue la politique de la « chaise vide » arguant du fait qu’une majorité des membres se réfère davantage des Etats-Unis, et que l’entrée de la Chine communiste est bloquée. Profitant de ce fait, les Américains font voter dans l’urgence deux résolutions – la 83 puis la 84 – établissant un contingent militaire fort de seize pays, dont la Grande-Bretagne, l’Australie, le Canada, la Turquie, la France, la Belgique, la Grèce (…). En pratique, les Américains sont très largement majoritaire. Le commandement de la force onusienne est confié au général Douglas Mac Arthur, alors commandant des forces US dans le Pacifique. C’est un militaire reconnu, qui a participé aux deux conflits mondiaux et qui vient de se couvrir de gloire dans la guerre contre le Japon.
Il n’est que temps !
En quelques jours, par des attaques surprises sur les villes de Kaesong, Chunchon, Uijongbu et Ongjin, les troupes du nord détruisent en grande partie la petite armée de Corée du Sud, bien faible avec ses 38.000 hommes. C’est même la débandade. Le 28 juin, Séoul tombe à son tour. Les communistes parviennent jusqu'à Pusan – au sud-est de la péninsule – en septembre 1950. Seule une poche autour de cette ville a pu résister au déferlement communiste. Avec cette incroyable avancée, les troupes Nord-coréennes ne parviennent pourtant pas à atteindre ses buts, à savoir la reddition de Sygman Rhee et l'anéantissement total de son armée. Kim Il-sung a pourtant promis à ses alliés une guerre éclair.
La reconquête.
La joie communiste n’est que de courte durée. Les troupes onusiennes de Mac Arthur organisent la contre-attaque, par l’arrivée de soldats majoritairement occidentaux (près de 200.000 hommes) et un appui aérien et logistique d’importance. Les troupes du nord sont alors repoussées jusqu'à la frontière Chinoise à peine deux mois plus tard, en novembre 1950, ce qui donne lieu à l'intervention non officielle de la Chine, qui envoie sur le champ de bataille des «volontaires» – près de 300.000 soldats – commandés par les généraux Lin Biao et Peng Dehuai. Avec ce renfort de taille, les forces de l'ONU sont stoppées nettes. Mieux, Séoul est reprise, ce qui entraîne un exode de près d’un million de Coréens.
Maintenant, au gré des batailles, la guerre de mouvement fait place à une guerre de position. Au moyen du sacrifice de nombreuses troupes, le général américain Ridgway parvient à reprendre Séoul, en mars 1951, et repousse les troupes de Corée du Nord au-delà du 38ème parallèle. Mais le général Mac Arthur ne peut se contenter du statu quo : il propose à son président, Truman, de lancer la bombe atomique sur la Mandchourie afin d’infléchir définitivement la position chinoise. Le président, refusant l’éventualité d’un conflit avec la Chine communiste, démet le général de ses fonctions et nomme Ridgway à sa place, en avril de la même année.
Le conflit s'enlise : les deux parties connaissant leurs lots de victoires et de défaites, bien que les deux camps entrent en négociation parallèle dès cette année-là. Elles se poursuivent d’ailleurs, et ce jusqu'en 1953, année de la disparition de Joseph Staline, le Petit père des peuples. Le 27 juillet 1953, est proclamé l'armistice de Panmunjeom. Il met fin à une guerre qui aura duré pratiquement 3 ans, et fait au minimum un million de morts (différentes sources mentionnent même des chiffres de 2-3 millions de morts).
Monclar et le Bataillon français de l’ONU.

Le lieutenant-colonel Monclar et le général Mac Arthur.
En novembre 1950, le Bataillon français de l’ONU est incorporé au sein du 23ème régiment de la deuxième division de l’infanterie US, sous le célèbre insigne Indian Red. Il est composé de plus de mille volontaires, commandés par un chef de premier ordre : le général Ralph Monclar.
Saint-cyrien, il termine la Première Guerre mondiale au 60ème régiment d’Infanterie avec le grade de capitaine, la Légion d’honneur, 11 citations et une invalidité de 90 % ! Par la suite, il est envoyé en Syrie afin d’y organiser le mandat de la France sur le pays dans les années 1920. Son invalidité ne l’empêche pas d’être l’un des premiers à répondre à l’appel du général de Gaulle, qui lui confie la 13ème Demi-brigade de la Légion étrangère à Narvik (Norvège) en 1940. Peu après, en Syrie, il se refuse à entamer des combats contre les troupes françaises restées fidèles au Gouvernement de Vichy. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il effectue des missions d’inspection pour la Légion en Algérie, au Maroc, à Madagascar, en Indochine. Au moment de la constitution du bataillon de l’ONU pour la Corée, il se porte volontaire, et échange, pour la durée de sa mission, ses étoiles de général de corps d’armée contre un grade de lieutenant-colonel.
Dès noël 1950, le Bataillon français de l’ONU (BF/ONU) s’installe dans la vallée de Mokkey-Dong, par un froid des plus glaciaux, allant jusqu’à -30°, rendant les armes complètement inutilisables. Dans ces conditions extrêmes, le bataillon perd accidentellement son premier soldat.
En janvier 1951, le Bataillon français participe à une série de combats victorieux, pendant près d’un mois. Après une difficile progression, il s’installe au sud de Chipyong-Ni et d’une voie ferrée, appelé Twin Tunnel, dans le centre de la péninsule, défendue par les 10.000 volontaires Chinois de la 125ème division. Le rapport est donc de 1 à 10 ! Le combat dure près de 14 heures, mais les Français tiennent bon, perdant seulement 30 hommes et une centaine de blessés. Les volontaires Chinois quant à eux déplorent la mort de plus de 1.300 hommes. Ce combat vaut sa première citation à l’ordre de l’Armée française et sa première Citation présidentielle américaine.
Monclar se dirige sur Chipyong-Ni, carrefour stratégique important, isolé face à l’ennemi. Le 23ème régiment US et le BF/ONU sont alors encerclés par 4 divisions chinoises, soit près de 45.000 hommes. Après trois jours de combats, et avec l’aide de l’aviation, les troupes chinoises sont repoussées. Le Bataillon français obtient deux nouvelles citations, à l’ordre de l’Armée et une nouvelle Citation présidentielle américaine. Mais le général Monclar, frappé par la limite d’âge, rentre en France.

Camp Payong – 1952
(Photographie de Stanislas Salisz).
Par la suite, le BF/ONU participe encore à de nombreux combats. En mars 1951, la prise de la cote 1037 ouvre la route de Chuchon et d’Honchon, au nord de Séoul. Le 6 avril, il franchit le 38ème parallèle, et arrive deux jours plus tard aux réservoirs de Hwachon. Repoussé par une contre-offensive, il refranchit le 38ème pour s’établir dans la ville d’Inje. En octobre de la même année, après trois semaines de combats, le BF/ONU s’empare de la cote 851 puis du piton Crève-Cœur. S’ensuit une guerre de position. Dans le courant de l’été 1952, le Bataillon français participe au barrage d’une nouvelle offensive chinoise sur Séoul. Placée en avant, la Section des Pionniers, à court de munitions, prend l’initiative d’un corps à corps à coup de pelles ! La Section d’armes lourdes se porte à son secours, désobéissant aux ordres. Mais pour ce fait d’armes, elle recevra sur ordre du Président de la République de Corée du Sud, la haute décoration de l’Ordre du mérite militaire Hwarang, avec étoile d’argent. Puis, le bataillon prend part aux combats du triangle de fer, nom d’un important gisement de minerai de fer entre Kumwa, Chorwon et Pyongyang, dans l’ouest de la péninsule.
C’est à la suite de ses blessures reçu lors d’une de ces batailles, que Jacques Landry, un Isséen de 25 ans, décède le 30 mai 1952. Il était brancardier au sein de la compagnie de commandement du bataillon.
L’année suivante, le BF/ONU est à Songkok et tient pendant plusieurs mois le secteur de Chumgasan, à l’ouest de Gumhwa, dans le centre du pays.

Jacques Landry et le médecin-capitaine Brottin en Corée.
(Photographie de Rémond Shappacher).
Giovanni Gandolfo
Comité du Souvenir Français d’Issy-les-Moulineaux.
Sources :
· La guerre de Corée, Robert Leckie, Ed. Robert Laffont, 1962.
· Histoire de la Corée, André Fabre, Ed. L’Asiathèque, 2000.
· La guerre de Corée (1950-1953),Patrick Souty, Presses universitaires de Lyon, 2002.
· Sites internet :
o http://commandos-marine.winnerbb.net/

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)
/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)