Dès la proclamation de l’armistice, la perspective du retour au foyer des quatre millions de mobilisés de l’armée française (dont peut-être 300000 soldats des anciennes colonies) est sans doute le plus grand facteur de joie des soldats et de leurs familles. Le gouvernement est conscient de ces aspirations. Mais il tient à conserver une armée puissante jusqu’à la signature de la paix définitive imposée à l’Allemagne vaincue, acte qui n’intervient que le 28 juin 1919, avec le traité de Versailles. D’autres préoccupations internationales (Europe centrale et orientale, Russie et pays du Levant) incitent également à la vigilance.
Organiser la démobilisation.
Le renvoi des soldats à la vie civile s’effectue donc de façon échelonnée, avec priorité donnée à l’ancienneté. Dès la fin novembre, les hommes les plus âgés (49 à 51 ans) peuvent rentrer dans leurs foyers. Les hommes de 32 à 48 ans sont pareillement renvoyés chez eux de décembre à avril. À ce moment, les dirigeants alliés s’alarment des réticences exprimées en Allemagne à l’égard de conditions jugées trop dures, et envisagent explicitement une intervention militaire destinée à contraindre les vaincus à se soumettre.
Le processus de démobilisation est donc interrompu. Les classes constituant la réserve de l’armée active, c’est-à-dire comprenant les soldats de moins de 32 ans, sont maintenues sous les drapeaux jusqu’en juillet 1919. Si plus d’un million de soldats ont été démobilisés à cette date, l’armée française compte encore 2,5 millions d’hommes aux armées contre un peu plus de 4 millions le 11 novembre 1918. Puis la démobilisation reprend, et s’opère en 4 échelons jusqu’en septembre. C’est seulement le 14 octobre 1919 qu’est signé le décret de démobilisation générale. Le renvoi des originaires des colonies s’opère de la même façon. En revanche, pour ceux, nombreux, qui ont contracté des engagements pour la durée de la guerre, leurs contrats stipulent que la démobilisation ne doit intervenir que six mois après la fin des hostilités, ce qui signifie, au mieux, le mois de mai 1919, en retenant la date de l’armistice comme date de référence. En septembre 1919, il resterait en France environ 15 000 militaires "indigènes", dont 13 000 Indochinois, surtout vietnamiens, essentiellement infirmiers et conducteurs. Ils regagnent leur pays entre septembre et novembre.
Cet échelonnement est rarement apprécié des intéressés, même quand il donne à certains d’entre eux le grand souvenir d’avoir participé au défilé du 14 juillet 1919 sous l’Arc de Triomphe. Il introduit un certain désordre dans la composition des unités, qu’il faut réorganiser pour tenir compte des départs. Par ailleurs, la discipline a tendance à se relâcher, les soldats-citoyens estimant que la fin de la menace allemande ne justifie plus l’application de règlements auxquels la grande majorité s’est soumise avec une sourde révolte, et à l’égard desquels elle conserve un vif ressentiment. Pour les démobilisés, le départ de l’armée ne va pas toujours sans difficultés. La procédure est pourtant simple : une visite médicale, la mise à jour des papiers militaires, puis l’envoi vers le centre démobilisateur qui est le dépôt du régiment d’appartenance de l’intéressé. Mais les désordres sont fréquents, particulièrement dans les transports ferroviaires : les soldats, pour protester contre la lenteur des convois et l’inconfort des wagons, brisent fréquemment vitres ou portières. Des manifestations se produisent chez les tirailleurs sénégalais du camp de Saint-Raphaël, qui, à l’occasion d’une revue, bousculent un général et demandent bruyamment leur retour. Il faut dire que, faute de moyens de transport maritimes, le rapatriement des soldats d’outre-mer est encore plus difficile.
Quitter l’armée et retrouver son foyer.
Les premiers retours créent bien des désillusions. Les hommes rentrent en effet dans l’indifférence des autorités, sans cérémonie d’aucune sorte. Pour remplacer les vêtements laissés à la caserne, abandonnés ou abîmés, ils ne reçoivent qu’un costume mal taillé (dit "Abrami", du nom du sous-secrétaire d'État à la Guerre Léon Abrami), ou, s’ils le refusent, la somme ridicule de 52 francs, peut-être 50 euros d’aujourd’hui. Ils sont même sommés par l’administration fiscale de payer leurs arriérés d’impôts, la fin du moratoire en la matière ayant en effet été décrétée dès la fin des hostilités. C’est seulement à partir de mars 1919 que des mesures plus compréhensives viennent remédier à ces maladresses : rétablissement du moratoire des impôts, paiement d’une prime à la démobilisation calculée selon un barème plus décent (250 francs plus 20 francs par mois de présence au front), loi sur les pensions versées aux invalides de guerre ou aux familles des décédés. L’accueil s’est modifié aussi.
À partir de la signature du traité de Versailles, les retours des régiments qui reviennent dans leur localité d’attache sont désormais célébrés : la fête commence par le défilé des soldats, acclamés par la foule de leurs compatriotes, dans des rues pavoisées et ornées de feuillages ; l’émotion est d’autant plus forte que beaucoup de ceux qui défilent, en dépit du brassage survenus dans les régiments au cours du conflit, sont encore des enfants du pays. Le défilé est parfois, mais pas toujours, suivi de festivités diverses (concerts, bals, feux d’artifice, retraites aux flambeaux). Même quand elles ont lieu, ces fêtes ne peuvent, cependant, cacher le deuil que manifeste pour de nombreuses années la présence des mutilés, mais aussi celle des veuves ou des familles dont les vêtements noirs de deuil rappellent tous ceux qui ne reviendront jamais.
Les démobilisés doivent aussi faire un gros effort de réadaptation. Ils ont vécu, pendant plusieurs années, 5 ans pour certains, au milieu de leurs camarades, loin de leurs familles, et coupés du milieu civil, à l’exception de rares permissions. Il leur faut d’abord retrouver du travail, ce qui n’est pas toujours aisé. Même si une loi de 1918 oblige les patrons à rembaucher leurs anciens ouvriers ou employés, encore faut-il que ces patrons soient encore en activité et en mesure de le faire. Il leur faut aussi accomplir toute une série de démarches, longues et souvent vécues comme humiliantes, pour obtenir les indemnités auxquelles ils ont droit. Mais il ne s’agit pas seulement de trouver du travail. L’homme libéré, dont jusque-là le quotidien était pris en charge par l’armée, a oublié comment régler son rythme de vie, pourvoir individuellement à ses besoins, choisir comment se nourrir ou se vêtir. Tout particulièrement, la vie familiale est à réorganiser, avec des épouses qui, bon gré mal gré, ont pris les responsabilités dévolues aux chefs de famille, des enfants qui ont perdu un temps leur père ou n’ont jamais connu sa présence. Des couples se sont défaits ou se défont, et les divorces sont plus nombreux qu’avant la guerre.
Les démobilisés estiment enfin qu’ils ne peuvent rien communiquer de leur expérience à ceux qui n’ont pas partagé les mêmes souffrances, les mêmes peurs, la même solidarité avec les camarades. Une partie des six millions et demi d’anciens combattants (environ un homme adulte sur deux) trouvent cependant dans les associations, comme l’Union Nationale des Combattants, un moyen d’exprimer leur solidarité et leurs revendications au sein de la société française. Leur état d’esprit se caractérise avant tout par la fierté d’avoir «tenu» dans l’épreuve, en s’accrochant à leurs positions, comme à Verdun, pour empêcher la masse des troupes allemandes de se déverser sur le pays. Ils ressentent infiniment plus la satisfaction du devoir accompli que l’exaltation de l’exploit guerrier, même si tous n’y ont pas été insensibles. Plus la guerre s’éloigne, plus se renforce chez la majorité d’entre eux un patriotisme très pacifique, voire pacifiste, marqué avant tout par la condamnation de la guerre, et un rejet de tout ce qui peut la faciliter : notamment le militarisme, l’exaltation de l’héroïsme guerrier voire même, dans certains cas extrêmes, il est vrai, de l’honneur qui fait préférer la mort à la servitude.
Quel sort pour les autres « mobilisés » de la guerre ?
La fin de la guerre concerne d’autres catégories de soldats. Les prisonniers français, dont le nombre peut être évalué à 500 000, ont eu la possibilité de quitter les camps dès l’armistice. Nombre d’entre eux prennent l’initiative de rentrer par leurs propres moyens, non sans difficultés. Les autorités françaises prennent en charge le rapatriement des autres. Deux mois, de mi-novembre 1918 à mi-janvier 1919, suffisent pour assurer l’essentiel des retours. Ceux-ci se font dans l’indifférence des autorités et de l’opinion, comme si une sorte de déshonneur s’attachait à la condition de ces anciens soldats, qui, pour la plupart, n’ont pourtant pas démérité. Les règlements les assimilent d’ailleurs aux autres anciens combattants pour les indemnités qui leur sont dues.
Tout aussi discrète, pour des motifs compréhensibles, est la démobilisation des Alsaciens et Lorrains des territoires annexés au Reich depuis 1871, qui ont servi dans l’armée impériale (au nombre de 250 000 pendant la durée de la guerre). Pour tenter de remédier aux incompréhensions et aux injustices que fait naître leur situation de Français ayant servi dans une armée ennemie, une première association est créée dès 1920 sous le patronage du grand écrivain patriote Maurice Barrès, et prend le nom explicite de "malgré-nous", appelé à être de nouveau employé, à la suite de circonstances encore plus tragiques, lors de la Seconde Guerre mondiale.
Encore plus négligée est la démobilisation d’un certain nombre de femmes, appelées pendant le conflit à exercer des travaux jusque-là largement attribués aux hommes dans l’industrie et les services. Elles doivent accepter de quitter leur travail pour redevenir femmes au foyer ou employées de maison, sous la pression des autorités (circulaire du ministre de l’Armement Louis Loucheur du 13 novembre 1918). Ce transfert s’effectue sans beaucoup de bruit, et laisse peu de traces.
Remise en cause ou maintien de l’ordre colonial ?
La rentrée des démobilisés des colonies est souvent marquée, elle aussi, par des solennités. Dans une allocution prononcée à Alger, le général Nivelle, venu souhaiter la bienvenue aux tirailleurs et aux zouaves qui regagnent leurs garnisons, exalte leur héroïsme, leur esprit de sacrifice et leur foi invincible. Cet accueil s’adresse surtout, il est vrai, aux premiers contingents rapatriés, les suivants débarquant dans une plus grande indifférence. Dans certains cas, les autorités paraissent se préoccuper de préparer la réadaptation des combattants. Une brochure est ainsi distribuée aux démobilisés d’Indochine pour leur indiquer les formalités à remplir afin de faire valoir leurs droits. Ils sont soumis à une visite médicale, les blessés ou malades étant soignés dans des formations sanitaires.
Cette sollicitude ne signifie pas un abandon de la surveillance. Toujours en Indochine, un service des rapatriés, mis sur pied dès septembre 1917, reçoit pour mission de centraliser les informations sur les "indigènes" en métropole, de manière à signaler les problèmes éventuels, mais aussi les écarts divers dans les comportements individuels, dont mention est faite aux services de la Sûreté locale. Il faut dire que, dans certaines régions, les arrivées ont donné lieu à des incidents : à Djibouti, au printemps de 1919, les soldats démobilisés, dont certains se sont illustrés sur le champ de bataille (notamment lors de la reprise de Douaumont en octobre 1916), se mutinent. Certains, retournés dans leurs campements, se livrent au pillage. Des incidents éclatent en ville. D’autres agitations analogues se produisent en Afrique occidentale française (AOF), notamment au Sénégal et en Guinée. Aucune, cependant, ne dégénère en troubles graves. Les travailleurs recrutés dans les colonies à l’occasion de la guerre (dont le nombre est évalué à 200 000) regagnent, eux aussi, leur pays en très grand nombre. Les autorités ne désirent pas les maintenir sur place. Elles craignent qu’ils ne soient contaminés par les idées révolutionnaires qui paraissent faire de grand progrès au sein du prolétariat français. Elles trouvent en les renvoyant l’occasion de donner une satisfaction démagogique aux mécontentements populaires, alors que les combattants de retour du front sont encore à la recherche de travail. Enfin, les responsables des colonies souhaitent retrouver au plus vite l’intégralité de la main-d’œuvre "indigène", indispensable pour assurer la reprise économique des territoires en touchant des salaires ramenés à des niveaux plus bas grâce à la pression des rapatriés. Pour faire face aux besoins de la reconstruction en France, on juge préférable de faire appel à des originaires d’Europe, jugés plus efficaces et qui excitent moins la méfiance des syndicats, en raison de leur tradition ouvrière. On se contente d’employer un nombre réduit de coloniaux et de Chinois sur les premiers chantiers de déblayage du front, dans des conditions d’ailleurs souvent très dures et dangereuses. Le voyage de ceux qui rentrent est en principe pris en charge par l’État, mais l’administration ne s’empresse pas de satisfaire à ses obligations. Les Vietnamiens n’achèvent de regagner leur pays qu’en juillet 1920.
Comme leurs camarades en métropole, les anciens combattants, Européens ou "indigènes", évoquent peu les réalités de la guerre. Certains ont tendance à attribuer l’attitude de ces derniers à un «fatalisme», qui les rendrait indifférents aux plus prodigieux événements, et non au désir d’oublier très répandu chez les anciens combattants. De retour chez eux, ces mêmes "indigènes" ne contribuent pas moins à remettre en cause l’ordre d’avant-guerre, l’ordre imposé par l’autorité coloniale, mais aussi celui des sociétés traditionnelles. La soumission à leurs propres notables et à leurs anciens leur pèse.
Ils excipent de leur qualité d’anciens soldats de l’armée française pour chercher à échapper aux injonctions de l’administration. En AOF, des chefs dénoncent l'arrogance des démobilisés et les accusent d’avoir acquis au service des habitudes de paresse qui les poussent à la délinquance. Beaucoup en revanche jouissent, dans le peuple, de la considération que leur vaut leur maîtrise apparente des "manières de Blancs" : ils fument le tabac, connaissent quelques mots de français, peuvent exhiber des "papiers" officiels. On admire leurs actions militaires, dans une société au sein de laquelle le guerrier jouit d’un grand prestige. Leur prime de démobilisation, versée en une seule fois et souvent dépensée en cadeaux, leur vaut, au moins dans les débuts, un certain prestige dans des milieux contraints à une existence frugale.
Par ailleurs, certains rapatriés ont acquis, au contact de l’Europe, une nouvelle conscience politique et de nouvelles pratiques d’action. Un ancien combattant, Dorothée Lima, fonde en 1920 le premier journal dahoméen, la Voix du Dahomey. Un ouvrier, Tôn Duc Thang, de retour de France, et qui a peut-être participé aux mutineries de la Mer Noire, crée le premier syndicat de Saigon. Chez d’autres, le passage par l’armée a plutôt confirmé une vocation politique, comme chez l’instituteur Jean Ralaimongo, qui s’est porté volontaire à trente-deux ans et va devenir un des premiers animateurs du mouvement d’émancipation malgache, ou le comptable Galandou Diouf, bientôt devenu rival sénégalais de Blaise Diagne. On peut se demander cependant si ces comportements sont très fréquents parmi les anciens combattants. En effet, la plupart d’entre eux semblent plutôt rentrer de la guerre avec le désir de jouir de la paix, en bénéficiant des avantages que leur dispense le gouvernement et de l’estime de leur entourage.
Les vétérans et les anciens combattants d’origine européenne, notamment les Français d’Algérie, ont une attitude différente. Si leur mentalité apparaît assez proche de celle de leurs compatriotes de métropole, la situation coloniale donne à leur patriotisme une nuance particulière. Leur expérience de guerre, la fraternité d’arme qui a lié nombre d’entre eux à des soldats "indigènes", les innombrables exemples d’héroïsme et de dévouement fournis par ces derniers, paraissent plaider en faveur du maintien d’un ordre colonial qui a su engendrer ces comportements impeccables. Leur vision très positive de leurs anciens camarades de combat fait trop souvent peu de cas des conditions de vie, souvent difficiles, de ceux-ci ou de leurs aspirations, quand ils sont revenus à la vie civile, à échapper à la condition de "sujets". Tout en éprouvant à l’égard des "indigènes" plus d’affection et d’estime que par le passé, ceux qu’on n’appelle pas encore les "Pieds Noirs" ne sont guère davantage disposés à prêter l’oreille aux revendications de leurs représentants. Ces sentiments exagérément optimistes seront encore renforcés par la participation exemplaire des soldats des colonies lors de la Seconde Guerre mondiale.
Au total, la démobilisation peut paraître une réussite : les soldats ont été réintégrés sans heurts dans la vie civile. Les anciens combattants de métropole continuent à exprimer leur fidélité à la République, qui paraît sortie grandie de l’épreuve. Mais leurs attentes sont à la mesure des sacrifices qu’ils ont consentis : une vie plus heureuse, des gouvernements plus attentifs. Quant aux hommes mobilisés dans les colonies, la fierté d’avoir été de bons soldats alimente une revendication de dignité qui contribuera à nourrir l’aspiration à l’indépendance.
Sources :
Site Internet du Ministère des Armées : www.cheminsdememoire.gouv.fr
Ce texte a été écrit par Jacques Frémeaux - Professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne (Paris-IV), membre de l’Académie des Sciences d’Outre-mer et membre émérite de l’Institut universitaire de France.

/image%2F1492174%2F20200511%2Fob_280a1c_nouveau-logo-sf.jpg)
/image%2F1492174%2F20150326%2Fob_7141fa_2011-11-11-issy-009.jpg)
/image%2F1492174%2F20200912%2Fob_579e4d_capitaine-bonnabelle.png)




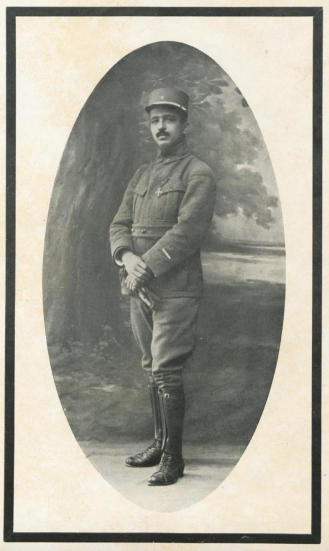






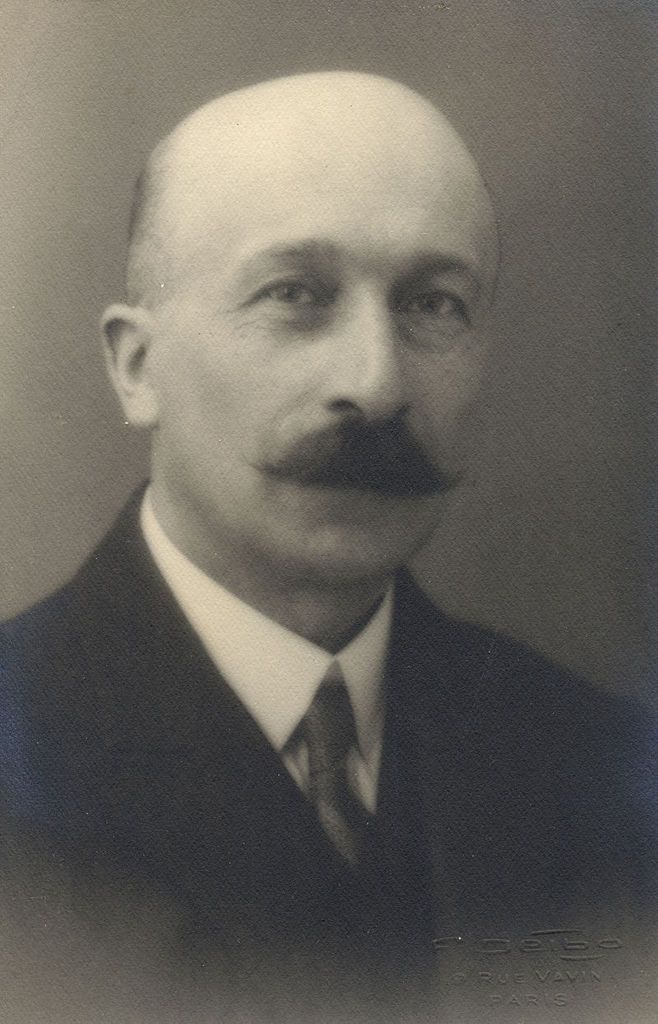

/image%2F1492174%2F20180801%2Fob_de3606_auffroy-henri.jpg)
/image%2F1492174%2F20180801%2Fob_34469e_bouvier-frederic.jpg)
/image%2F1492174%2F20180801%2Fob_eb0db5_constant-alexandre.jpg)
/image%2F1492174%2F20180801%2Fob_5e3c55_jacquart-eugene.jpg)
/image%2F1492174%2F20180801%2Fob_3ee213_le-tourneux-rene.jpg)
/image%2F1492174%2F20180801%2Fob_01f9c5_poisson-jean.jpg)
/image%2F1492174%2F20180801%2Fob_44eb4d_thelier-leon.jpg)